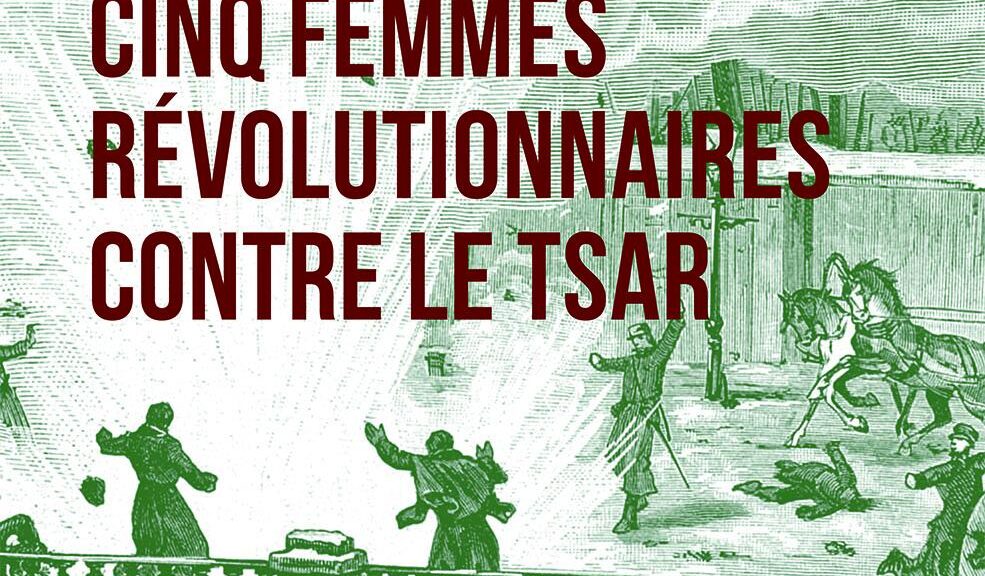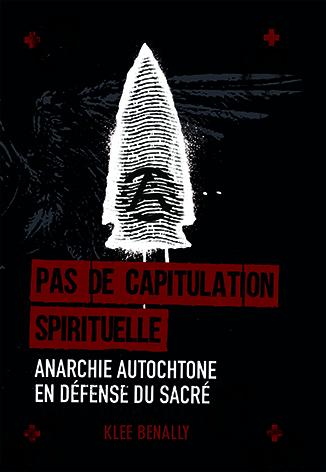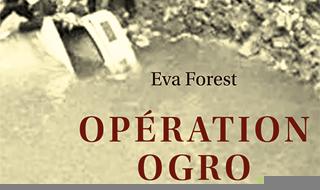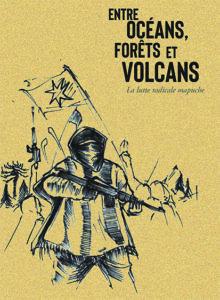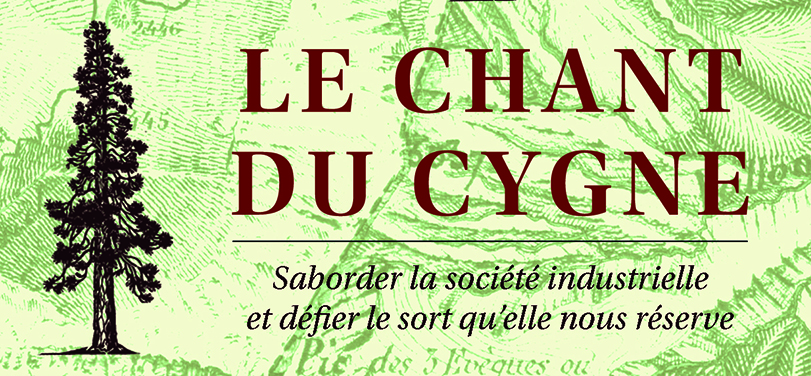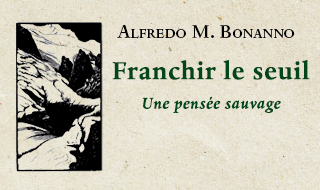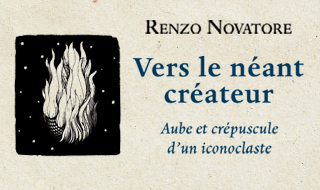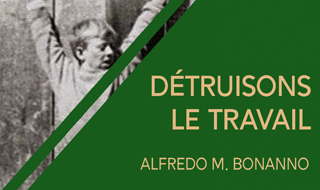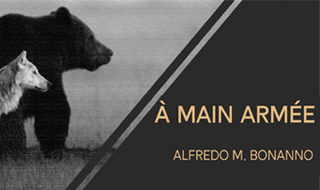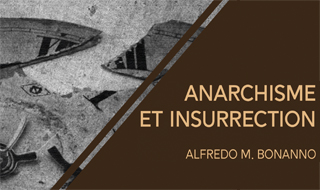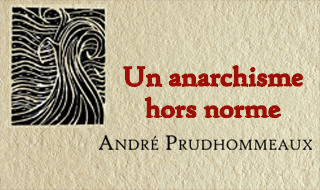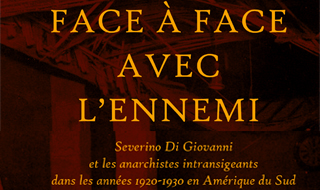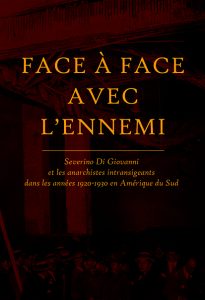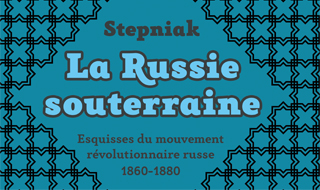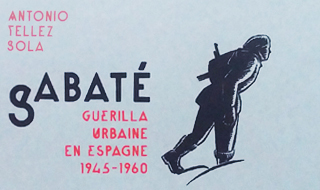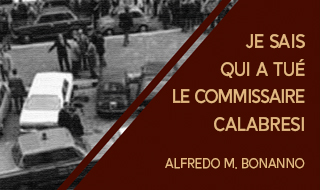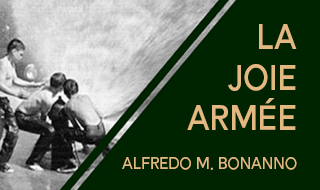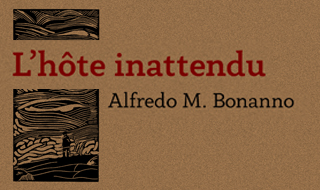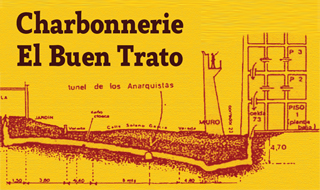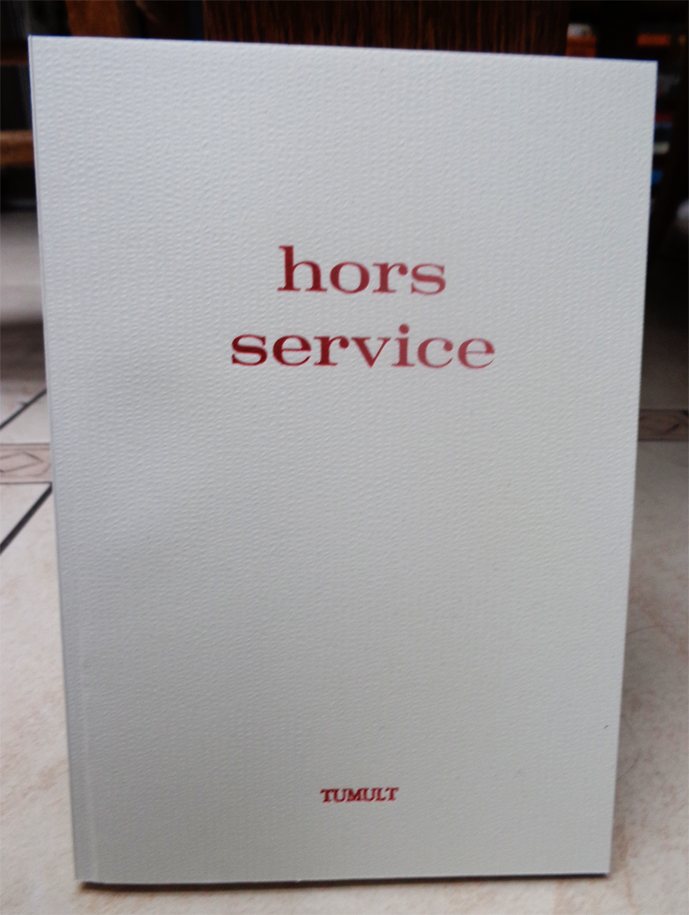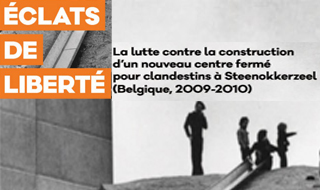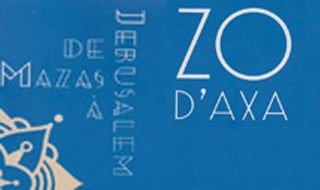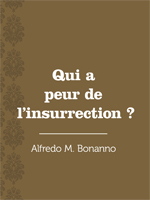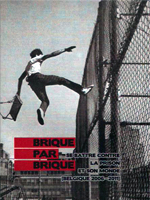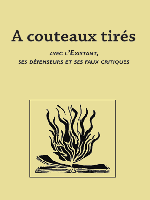Vera Zassoulitch, Praskovia Ivanovskaïa, Olga Lioubatovitch, Elisabeth Kovalskaïa et Vera Figner sont cinq conspiratrices fougueuses du mouvement révolutionnaire russe des années 1870-1880. Dix ans après l’abolition du servage, la première vague de lutte contre l’absolutisme tsariste prend principalement la forme d’une marche de la jeunesse vers le peuple paysan et ouvrier. Face à la répression, le mouvement se transforme : à la propagande et l’agitation s’ajoutent l’organisation secrète, la fomentation de révoltes paysannes, le combat armé et les attentats. Le 1er mars 1881, le tsar Alexandre II lui-même est tué lors d’un attentat à Pétersbourg.
Rédigés en partie dans l’isolement de l’exil ou le silence de la prison, ces récits autobiographiques retracent les extraordinaires parcours rebelles de ces cinq rêveuses de la liberté. Leurs mémoires racontent les multiples facettes de leur engagement révolutionnaire, notamment au sein de deux formidables organisations souterraines : Zemlia i Volia (« Terre et Liberté ») et Narodnaïa Volia (« La Volonté du Peuple »). Ils nous plongent dans l’agitation ouvrière et paysanne, les attentats et évasions, l’exaltation et le désir, les imprimeries clandestines, mais aussi la répression implacable, la vie rude dans la clandestinité, la douleur et le tourment, l’exil et la trahison. Nourris par l’élan de l’émancipation individuelle et la volonté de se libérer du carcan patriarcal, ce sont des récits intimes de farouches combats révolutionnaires.
hiver 2025
448 pages // 14 euros
Sommaire
Préface
Cinq soeurs contre le tsar (introduction
Vera Zassoulitch
Enfance et jeunesse
L’affaire Netchaïev
Souvenirs de Netchaïev
Souvenirs de l’attentat contre Trepov
Serge Mikhaïlovitch Kravtchinski
Éléments. Souvenirs personnels
Elisabeth Kovalskaïa
Autobiographie
Mes rencontres avec Sofia Perovskaïa
Olga Lioubatovitch
Le proche et le lointain
Praskovia Ivanovskaïa
Autobiographie
Vera Figner
Attentats
Le 1er mars 1881
Introduction
I
Dans les années 1870, le mouvement révolutionnaire russe atteint des proportions massives pour la première fois de son histoire. Le populisme révolutionnaire, dédié à la libération de la paysannerie opprimée, attire des milliers d’adhérents, et les chiffres des arrestations suggèrent qu’environ quinze pour cent d’entre eux sont des femmes. Les femmes participent à toutes les phases du mouvement, depuis la propagande auprès de la paysannerie, qui a prédominé au début de la décennie, jusqu’au « terrorisme », qui a culminé avec l’assassinat du tsar Alexandre II le 1er mars 1881. En outre, les femmes occupent souvent des postes de grande responsabilité. Parmi les cinq femmes dont les mémoires sont présentés dans ce livre, Olga Lioubatovitch, par exemple, a fait partie du premier groupe de propagandistes révolutionnaires à travailler comme ouvrières d’usine. En 1878, Vera Zassoulitch initie la phase terroriste en tentant d’assassiner le gouverneur de Pétersbourg. Àprès le 1er mars 1881, Vera Figner devient la principale dirigeante de La Volonté du Peuple, le parti qui a perpétré l’assassinat. Le rôle joué par les femmes, qui aurait été extraordinaire pour n’importe quel mouvement révolutionnaire du XIXe siècle, est d’autant plus remarquable que leur lutte se déroule dans une société strictement hiérarchisée, où les femmes sont considérees à peu de chose près comme propriété de leurs pères et de leurs maris. Juridiquement, les femmes sont soumises à l’autorité absolue de ceux-ci et, jusqu’en 1869, aucune éducation au-delà du niveau secondaire n’est accessible aux femmes, où que ce soit en Russie. Cette terrible oppression explique peut être pourquoi les femmes ont pris part de manière si importante au mouvement radical à partir des années 1850.
Dénonçant l’asservissement des femmes à la famille patriarcale, des écrivains masculins comme Tchernychevski prônent des relations amoureuses dans lesquelles les femmes peuvent conserver leur autonomie ; ils réclament une éducation supérieure et des emplois pour permettre aux femmes d’atteindre l’indépendance économique.
Au cours des années soixante, cette première formulation de la « question des femmes » se traduit par le fait que des centaines de jeunes femmes de la noblesse quittent leur foyer en quête d’autonomie individuelle. Dès le début, la libération individuelle et la libération sociale sont intimement liées, d’une part parce que ces femmes sont des pionnières, se rebellant contre les relations patriarcales qui oppriment toutes les femmes, et d’autre part parce qu’elles sentent qu’un bouleversement profond est nécessaire pour améliorer de manière significative la situation des femmes et du peuple en général. C’est pour cette raison que le célèbre roman de Nikolaï Tchernychevski, Que faire ?, a une telle influence. Ce roman devient un modèle, apportant des solutions pratiques à la « question des femmes » dans une perspective révolutionnaire : mariages « fictifs », contractés uniquement dans le but d’extraire les femmes du foyer de leurs parents ; chambres séparées pour les couples qui vivent ensemble afin de préserver l’indépendance émotionnelle et affective des deux parties ; et situations de vie et de travail collectives pour permettre aux femmes de survivre économiquement dans une société qui cherche à les priver de toute indépendance.
Mais c’est d’abord l’enseignement qui est jugé indispensable pour que les femmes accèdent à l’indépendance économique et à l’égalité intellectuelle avec les hommes, et c’est surtout cette soif de s’éduquer qui motive les femmes des années soixante et les rassemble. Àu cours de cette décennie, de nombreux groupes de femmes, comme celui d’Elisabeth Kovalskaïa à Kharkov, demandent en vain l’accès aux universités de Russie. Jusqu’en 1869, les femmes n’ont accès qu’à des pensionnats, dont les meilleurs n’offrent qu’une éducation superficielle, les cours de pédagogie ouverts à Pétersbourg en 1866 et quelques cours de formation de sages-femmes. Si les femmes veulent apprendre quelque chose d’autre, elles doivent le faire par elles-mêmes. C’est ainsi que les cercles d’auto-éducation (les groupes d’étude) se multiplient dans les années soixante.
Les femmes participent également activement aux efforts visant à étendre l’éducation élémentaire et politique à la classe ouvrière. Vera Zassoulitch, par exemple, enseigne dans les écoles du soir et les écoles du dimanche créées par les radicaux pour les travailleurs de Pétersbourg. À Kharkov, Elizabeth Kovalskaïa utilise son héritage pour créer une école du soir pour les travailleuses, où des conférences sont données sur le féminisme et le socialisme.
Au cours des années soixante, les femmes ne participent en général pas à d’autres formes d’activités radicales de manière intensive, ou sur un pied d’égalité avec les hommes. Certes, les hommes considérent les femmes comme des révolutionnaires potentielles et les aident souvent à se libérer – en contractant des mariages fictifs, par exemple. Mais en Russie, où les libertés civiles sont inexistantes et où le gouvernement emploie un vaste réseau d’espions policiers, le petit groupe clandestin – souvent formé autour d’un seul individu, invariablement un homme – devient la forme caractéristique de l’organisation révolutionnaire. Lorsque les femmes sont impliquées, elles jouent un rôle plutôt périphérique ou auxiliaire. Vera Zassoulitch, par exemple, est marginalement associée à Sergei Netchaïev, un révolutionnaire ambiguë actif dans le mouvement étudiant de la fin des années 1986. Dans son Catéchisme Révolutionnaire, écrit en collaboration avec Mikhaïl Bakounine, Netchaïev décrit le rôle des femmes dans le mouvement révolutionnaire. Selon lui, un premier groupe, « les têtes vides, les insensées, les sans-cœur », doit être exploité et devenir l’esclave des hommes. Un deuxième groupe, les femmes « enthousiastes, dévouées et capables » mais qui ne sont pas totalement engagées dans la révolution, doit être incité à révéler ses sympathies, après quoi la plupart d’entre elles périront, tandis que les autres deviendront de vraies révolutionnaires. Enfin, le troisième groupe de femmes, « qui sont vraiment des nôtres », doit être considéré comme « notre joyau le plus précieux, dont l’aide est absolument indispensable ». Mais même un « joyau de grande valeur », comme Zassoulitch, n’est qu’une aide, exclue de la direction et de la prise de décision. D’ailleurs, Netchaïev exige aussi une obéissance sans faille de la part des hommes de sa petite organisation révolutionnaire, et lorsque l’un d’entre eux, Ivan Ivanov, exprime certains doutes, Netchaïev décide qu’il devait être tué. À quatre autres membres du groupe, Netchaïev affirme disposer de preuves (qu’il n’a jamais produites) qu’Ivanov est un traître, et le 21 novembre 1869, ils passent à l’acte. Le corps d’Ivanov est rapidement découvert et, pendant plusieurs mois, la police arrête un grand nombre de radicaux dans le cadre de cette affaire, bien que certains n’aient quasiment pas de lien avec Netchaïev. Netchaïev lui-même réussit à s’enfuir à l’étranger et à échapper à la police tsariste pendant près de trois ans.
Les révélations produites par son procès ont beaucoup d’influence sur la forme du mouvement des années soixante-dix : dans les cercles radicaux, l’aversion pour ses méthodes dictatoriales et malhonnêtes sont si forte que, pendant des années, toute tentative de création d’une organisation tendant vers le centralisme suscite une grande méfiance. Les groupes révolutionnaires du début des années soixante-dix sont consciemment libertaires et égalitaires, se basant sur le principe de l’honnêteté et du respect mutuel entre camarades. Les femmes sont acceptées comme membres à part entière.
Les établissements d’enseignement supérieur jouent un rôle particulièrement important dans la formation des femmes révolutionnaires des années soixante-dix. La création des cours dit « Alarchinski » en 1869 marque un tournant dans le développement du mouvement des femmes en Russie. Le gouvernement avait fini par céder aux femmes désireuses de recevoir une éducation supérieure un accès à des programmes non diplômant. Dès le début des centaines de jeunes femmes venues de toute la Russie affluent à Pétersbourg.
Les cours Alarchinski sont pour les femmes une occasion inestimable de se rencontrer et de développer leurs idées sociales, tout en approfondissant leurs connaissances en sciences et en mathématiques. L’activité féministe y est florissante. Elisabeth Kovalskaïa décrit la succession ininterrompue de réunions au cours desquelles les étudiantes – les hommes en étaient exclus – discutent de leur position dans la famille et de leur rôle dans la société. Très vite, les sujets d’étude s’étendent à d’autres questions sociales, telles que la situation de la classe ouvrière et de la paysannerie. À partir de 1871, ces préoccupations « éclipsent » le féminisme pour une partie des femmes qui en viennent à penser que le besoin le plus pressant de la Russie est une « révolution sociale » – une révolution qui redistribuerait les terres parmi la paysannerie – et qu’elles peuvent mieux faire avancer cette cause en se joignant aux hommes au sein de groupes mixtes.
Une évolution similaire – en partant du féminisme pour aller vers le populisme révolutionnaire – a également lieu à Zurich. La création des cours Alarchinski n’ayant pas satisfait le désir des femmes de recevoir une formation professionnelle, un nombre croissant de femmes russes se rendent à l’étranger au début des années soixante-dix. En 1873, plus d’une centaine de femmes russes étudient la médecine en Suisse. À cette époque, la Suisse est également un refuge pour les radicaux russes en exil. La vie révolutionnaire est particulièrement intense à Zurich, et de nombreuses étudiantes russes s’y investissent : elles assistent aux réunions de la section locale de l’Association internationale des travailleurs (AIT, la première Internationale), dévorent les ouvrages importants du socialisme européen et participent à la composition du journal radical émigré Vpered ! (« En avant ! »), tout en poursuivant leurs études avec passion. Àfin d’approfondir les nouvelles idées qu’elles rencontrent, treize de ces étudiantes, dont aucune n’a plus de vingt ans, forment un groupe d’étude appellé le cercle Fritsche, du nom de la pension dans laquelle elles vivent. Le groupe comprend notamment Olga Lioubatovitch et sa jeune sœur Vera, ainsi que les sœurs Vera et Lydia Figner. En 1873, la plupart des membres du cercle décident de retourner en Russie pour y entreprendre des activités révolutionnaires. Elles entament des pourparlers avec un groupe de jeunes émigrés masculins et, en 1874, elles fusionnent pour former l’Organisation social-révolutionnaire panrusse.
Devenues populistes radicales, les membres du cercle Fritsche abandonnent le féminisme, comme l’avaient fait quelques années plus tôt les membres des cercles de femmes de Pétersbourg. Dans les années soixante-dix, les femmes et les hommes considérèrent que la libération des femmes est avant tout un combat pour l’autonomie individuelle des femmes, combat qui n’est pas perçu comme « prioritaire » dans un mouvement radical agissant dans les conditions politiques les plus dures et où les exigences conspiratives tendent si souvent à prendre le dessus des aspirations personnelles. Néanmoins, l’importance du mouvement féministe dans la formation des femmes révolutionnaires des années soixante-dix ne peut être minimisée. Il leur a permis de se rendre compte de leur propre capacité d’action, et offert l’expérience inestimable de développer leurs idées indépendamment des hommes ; grâce à cela, elles ont développé des liens de sororité qu’elles ont maintenus dans les groupes radicaux mixtes ultérieurs. Leurs propres forces ont permis aux femmes de participer sur un pied d’égalité au mouvement populiste.
II
Le 19 février 1861, le tsar Alexandre II libère les paysans (la grande majorité de la population) après des siècles de servage. Mais il ne leur donne pas les terres qu’’ils ont si longtemps cultivées et qu’ils estiment leur appartenir de droit ; ils sont obligés de les racheter au gouvernement à des prix qui dépassent parfois de loin la valeur marchande réelle. Le caractère insatisfaisant de l’ « Emancipation » provoque des actes de résistance violents mais sporadiques parmi les paysans. Parmi l’intelligentsia, il conduit à l’émergence de nombreux petits groupes qui croient à la nécessité et à l’imminence d’une révolution pour réaliser la redistribution des terres.
En 1866, Dimitri Karakozov, membre d’un de ces groupes révolutionnaires, paye de sa vie une tentative infructueuse d’assassinat du tsar. Lorsque ses geôliers lui demandent ses motivations, il répond : « Regardez la liberté que vous avez donnée aux paysans ! »
Les populistes n’ont jamais développé un corps de doctrine unifié comparable au marxisme, mais cela ne les empêchent pas de partager – au moins jusqu’à la fin des années 1870 – un certain nombre de principes fondamentaux. Elles pensent que la paysannerie est intrinsèquement socialiste (comme en témoigne leur culture communautaire de la terre) et qu’une révolution agraire permettrait à la Russie de passer directement au socialisme. Mais il est impératif que cette révolution soit réalisée immédiatement, car le capitalisme, bien qu’encore précoce en Russie, commence déjà à miner la communauté paysanne (« Obchtchina »). Une révolution « politique », visant à remplacer la forme absolutiste du gouvernement russe par un régime constitutionnel, ne serait d’aucune utilité pour la paysannerie ; seule une révolution « sociale », par et pour la paysannerie, peut ouvrir un horizon d’affranchissement et de liberté.
Mais comment les révolutionnaires issus des classes privilégiées doivent-ils aborder la paysannerie, le peuple ? Sur cette question, les radicaux russes ont tendance à se diviser en partisans de Piotr Lavrov et de Mikhaïl Bakounine, les deux écrivains qui ont le plus contribué à faire du populisme un mouvement de masse dans les années 1870. Dans ses Lettres historiques, publiées en 1870, Lavrov affirme que la culture des classes cultivées a été achetée à la sueur et au sang de la paysannerie laborieuse ; qu’en conséquence, l’intelligentsia privilégiée a une dette morale envers la paysannerie et que le moyen de rembourser cette dette est de mettre ses connaissances au service du peuple. Bakounine, quant à lui, soutient que le devoir du révolutionnaire n’est pas d’enseigner, mais d’apprendre des masses paysannes et de fusionner avec elles. La paysannerie est toujours prête pour la révolution – Bakounine rappelle constamment les rébellions paysannes massives respectivement menées par Stenka Razin et Emilian Pougatchev aux XVIIe et XVIIIe siècles – et n’a besoin que d’une étincelle pour la déclencher. Le révolutionnaire doit fournir cette étincelle et aider à unifier les rébellions locales en un soulèvement à l’échelle nationale.
Des débats houleux éclatent entre les partisans respectifs de Bakounine et de Lavrov. Mais lorsque le premier mouvement de masse « vers le peuple » se matérialise en 1874, il est essentiellement spontané et non coordonné, et il s’accommode aisément des deux orientations. Cet été-là, des milliers de jeunes gens – principalement des étudiants et des étudiantes – se rendent dans les campagnes russes, seuls ou en petits groupes, pour partager la vie des gens du peuple et diffuser la propagande socialiste. Ils s’habillent en paysans et apprennent parfois des métiers comme celui de cordonnier dans l’espoir de trouver du travail et d’établir des contacts avec la population. Certaines s’installent à un endroit précis, mais la plupart font de la « propagande volante », c’est-à-dire qu’elles se déplacent rapidement de village en village. Les idées socialistes qu’elles prêchent prennent parfois la forme de paraboles formulées dans la langue des gens du peuple, mais souvent les propagandistes se contentent de paraphraser leurs propres lectures des ouvrages socialistes d’Europe occidentale. La réaction des paysans est variable : peu sont sympathisants, la majorité est déconcertée, indifférente, voire hostile. En aucun cas les populistes des villes ne réussissent à déclencher un soulèvement révolutionnaire. Les propagandistes révolutionnaires agissent généralement ouvertement, sans se soucier de leur sécurité personnelle, et tous, sauf quelques-uns, tombent entre les mains de la police. Certains sont dénoncés par les paysans mêmes. À la fin de l’année, quatre mille personnes sont arrêtées, interrogées ou emprisonnées.
Les membres de l’Organisation social-révolutionnaire panrusse adoptent une approche différente lorsqu’ils rentrent en Russie au début de l’année 1875. Comme toutes les populistes du début des années soixante-dix, elles sont convaincues que la paysannerie doit être la principale force de la révolution. Mais plutôt que de s’organiser parmi les paysans eux-mêmes, ils prennent le parti de faire de la propagande parmi les ouvriers d’usine, qui sont pour la plupart saisonniers : lorsque ces ouvriers retournent périodiquement dans leur village natal pour aider aux travaux agricoles, ils sont alors en mesure de diffuser les idées socialistes plus efficacement que ne le feraient des étrangers venus des villes. L’organisation, dont fait partie Olga Lioubatovich et Lydia, la sœur de Vera Figner, établit des contacts avec des travailleurs dans plusieurs villes, mais en l’espace de six mois, tous les membres tombent entre les mains de la police.
Ainsi, bien que loin d’être vaincu, le mouvement populiste subit, à la fin de l’année 1875, de graves revers. Une grande partie des révolutionnaires du début des années soixante-dix sont emprisonnés ou surveillés par la police. Néanmoins, reste des individus pour arpenter librement les campagnes (comme Praskovia Ivanovskaïa pendant l’été 1876), et divers groupes et organisations qui développent de nouvelles stratégies pour approcher la paysannerie, fomenter des révoltes et répandre la subversion social-révolutionnaire.
Zemlia i Volia (« Terre et Liberté »), qui devient la plus importante de ces organisations, prend forme en 1876. Selon l’analyse partagé par ses membres, la première vague « vers le peuple » de 1874 a été trop aléatoire et imprudente et sa propagande trop abstraite. Bien que Terre et Liberté n’ait pas établi une hiérarchie élaborée, il s’agit bien d’une organisation clandestine, avec un groupe de coordination à Pétersbourg qui adhère strictement aux pratiques conspiratrices – appartements et adresses connus seulement de certaines personnes, faux papiers d’identité, précautions dans l’utilisation des communications écrites. Le programme de l’organisation est basé sur ce qui est perçu des désirs et des demandes existants du peuple : l’expropriation de toutes les terres et leur redistribution parmi la paysannerie ; l’éclatement de l’Empire russe conformément aux aspirations populaires à l’autonomie locale ; et l’autogouvernement par le biais de fédérations de communes paysannes. Bien entendu, ces revendications ne peuvent être réalisées que par une révolution violente. Mais Terre et Liberté adopte une approche prudente et à long terme pour diffuser ces idées. Àu lieu d’une « propagande volante », des bases plus durables – les « colonies » – sont établies dans les campagnes ; les révolutionnaires prennent des emplois dans ces lieux en tant qu’auxiliaires médicaux, infirmières, institutrices ou employés de bureau dans l’espoir de gagner progressivement la confiance de la population locale. Cette forme d’activité est devenue la forme dominante de la deuxième phase du mouvement « vers le peuple » au cours des années 1877-78 – non seulement pour les membres de Terre et Liberté, mais aussi pour des personnes comme Vera Figner et Elisabeth Kovalskaïa, qui ont choisi de ne pas adhérer à la nouvelle société secrète.
Entre-temps, deux procès de masse contribuent à créer une large sympathie du public pour la cause révolutionnaire. Le procès des Cinquante, qui se tient à Moscou en mars 1877, concerne la plupart des membres de l’Organisation social-révolutionnaire panrusse. Le gouvernement s’attend avec confiance à discréditer les révolutionnaires en les faisant passer pour une bande de criminels cyniques et dangereux. Àu lieu de cela, les spectateurs et les journalistes retiennent l’image de jeunes gens idéalistes qui, au nom de la justice sociale, ont renoncé à leurs positions privilégiées et partagé la vie misérable des ouvriers d’usine. Les femmes accusées, en particulier, font forte impression : les spectateurs de la salle d’audience s’exclament à plusieurs reprises : « Ce sont des saintes ! ». L’une des accusées, Sofia Bardina,conclu sa déclaration à la cour par un défi retentissant : « Persécutez-nous, tant que vous avez pour vous la force matérielle, Messieurs ; mais nous avons pour nous la force mentale, la force du progrès historique, la force des idées, et les idées ne se détruisent pas à la baïonnette !… »
Le procès des Cent quatre-vingt-treize, qui s’ouvre en octobre de cette même année 1877, voit sur le banc des accusés un grand nombre de révolutionnaires qui sont allés « vers le peuple » en 1874. Pour avoir répandu le socialisme dans la paysannerie, ils ont subi jusqu’à quatre ans d’emprisonnement préventif dans les conditions les plus dures ; des dizaines d’entre elles ont été emportées par la maladie, la mort (parfois par suicide) ou la folie. Lors du procès, de nombreuses accusées expriment leur mépris pour le tribunal en refusant de présenter une défense, et lorsqu’un homme tente de décrire les conditions de détention et de faire une déclaration politique, il est réduit au silence à plusieurs reprises par les juges et finalement traîné hors de la salle d’audience. Le gouvernement ne parvient pas à prouver l’existence d’une conspiration (de nombreux accusés ne ses sont jamais vus) ; il arrive seulement à discréditer ses propres méthodes. Les accusés, quant à eux, profitent de ce procès de plusieurs mois pour se faire des connaissances et renforcer leurs solidarités. À la fin du procès, la majorité d’entre eux sont acquittés ou libérés en contrepartie de leur emprisonnement préventif.
La prison les ayant endurcis et renforcés dans leurs convictions, ils reprennent leur activité politique (beaucoup rejoignent rapidement Terre et Liberté) avec la détermination d’éviter les erreurs naïves qui avaient fait d’eux des cibles faciles pour la répression gouvernementale des années auparavant. Le procès s’achève le 23 janvier 1878. Vingt-quatre heures plus tard, le mouvement populiste entre dans sa phase « terroriste ». Le terrorisme populiste consiste principalement en des assassinats de fonctionnaires d’État. Comme le soulignèrent ses partisans, il s’agit d’une forme très sélective de violence révolutionnaire, visant à « désorganiser » les structures de l’État. La « lutte terroriste », c’est tout simplement le populisme dans sa phase armée. C’est dans cette phase du mouvement révolutionnaire que les cinq femmes présentées dans ce livre ont joué leur rôle historique.
Le 24 janvier au matin, Vera Zassoulitch entre dans le bureau du général Trepov à Pétersbourg et, en présence d’une salle remplie de témoins, lui tire dessus pour se venger des mauvais traitements qu’il a infligés à un prisonnier politique. Six jours plus tard, une fusillade a lieu lorsque la police tente de perquisitionner une presse clandestine à Odessa ; le 23 février, une tentative d’assassinat d’un procureur adjoint à Kiev échoue ; le 25 mai, un fonctionnaire de police de Kiev est assassiné. Puis, le 4 août 1878, Sergei Kravchinskii, l’un des principaux membres de Terre et Liberté, assassine Mezentsov, le chef de la police politique en pleine rue à Pétersbourg et s’enfuit sans encombre. L’assassinat est revendiqué dix jours plus tard par le biais d’un manifeste intitulé « Mort pour mort » envoyé à un quotidien de Pétersbourg. Confronté à cette hausse de subversion armée, le gouvernement institue des tribunaux militaires spéciaux et exécute les protagonistes lorsqu’il les attrape. Mais la campagne se poursuit : résistance armée contre la police à Pétersbourg en octobre et à Kharkov en novembre ; assassinat du gouverneur de Kharkov en février 1879 ; tentative d’assassinat du chef de la police à Pétersbourg en mars 1879.
Jusqu’à l’automne 1878, Terre et Liberté, qui est devenue l’organisation révolutionnaire la plus importante et la plus forte, considère ce type d’activité comme strictement subordonné à la tâche d’organiser une révolution au sein de la paysannerie. C’est un moyen de venger les camarades tombés au combat, d’effrayer les fonctionnaires et de les dissuader d’exercer de nouvelles représailles contre les révolutionnaires, et, par l’exemple, de stimuler la résistance populaire au régime. Mais à la fin de l’année 1878, le harcèlement et la répression du gouvernement, tels que décrits par Vera Figner, rendent pratiquement impossible la propagande ou la simple vie parmi la paysannerie – presque toutes les colonies de Terre et Liberté doivent être abandonnées – et une faction croissante au sein du mouvement révolutionnaire soutient qu’il ne sera en fait jamais possible d’organiser la paysannerie en l’absence de libertés politiques de base telles que la liberté d’expression, de la presse et de réunion. L’accent doit se déplacer de la révolution sociale – c’est-à-dire une révolution ayant pour objectif immédiat d’obtenir des terres pour la paysannerie et de faire éclore l’autonomie des communes libres – vers une révolution politique contraignant le régime à faire des concessions au moyen d’attaques systématiques contre les hauts fonctionnaires. Même les plus ardents défenseurs de l’organisation traditionnelle de la paysannerie doivent admettre que leur approche se trouve dans une impasse. Mais certaines s’opposent fermement à la nouvelle ligne « politique » au motif que les attaques contre les fonctionnaires augmenteraient la répression et rendraient l’organisation plus difficile (un argument peu convaincant dans ces circonstances, comme le souligne Olga Lioubatovich) ; et que si un régime constitutionnel consacré à la protection des droits politiques était mis en place, il ne profiterait qu’à la bourgeoisie et n’améliorerait en rien le sort de la paysannerie.
Le conflit atteint son paroxysme en mars 1879, lorsqu’Alexandre Soloviev présente à Terre et Liberté un projet d’assassinat du tsar. Les partisans de la révolution politique approuvent, les partisans de l’organisation de la paysannerie s’y opposent farouchement. Ils trouvent un compromis, masquant le fossé qui se creuse: chaque membre individuellement peut choisir d’aider Soloviev, mais l’organisation dans son ensemble n’apportera aucun soutien. En fin de compte, Soloviev tente sa chance seul le 2 avril et échoue. Àprès quoi les « politiques » n’abandonnent pas l’idée du régicide. Àu cours des semaines suivantes, ils organisent leur propre groupe secret au sein de Terre et Liberté – nommé Liberté ou Mort – et commencent à mettre en place des ateliers de fabrication de dynamite.
Aucune des deux factions de Terre et Liberté ne se réjouissent de la perspective d’une scission formelle, qui signifierait la rupture de liens anciens et solides avec des camarades et, très probablement, l’affaiblissement du mouvement révolutionnaire. Mais il est urgent de résoudre le conflit, d’une manière ou d’une autre, et une conférence est donc organisée fin juin dans la ville de Voronej. Ànticipant une rupture ouverte, les partisans de la lutte politique tiennent une réunion préliminaire secrète à Lipetsk quelques jours avant l’assemblée de Voronej. Ils y exposent un programme réclamant des libertés civiles et une assemblée nationale élue au suffrage universel, approuvent à l’unanimité le principe du régicide et élaborent les statuts d’une organisation strictement centralisée. La scission attendue ne se concrétise pas à Voronej. Un autre compromis est trouvé, conservant l’ancien programme de Terre et Liberté mais approuvant la poursuite de la campagne d’assassinats et le principe du régicide. Cependant, le régicide ne peut rester une question abstraite, ni une question susceptible de faire l’objet d’un compromis.
En août, après deux mois de négociations infructueuses au sein de l’organisation (décrites par Lioubatovitch), les deux factions acceptent de se séparer. Ce schisme au sein de Terre et Liberté au cours de l’été 1879 est probablement l’événement le plus important dans l’histoire du mouvement populiste révolutionnaire. Deux organisations indépendantes émergent alors : les partisans du régicide et de la lutte politique créent la Narodnaïa Volia, La Volonté du Peuple, et leurs opposants qui se rassemblent autour de Tscherni Peredel, le Partage Noir.
Partage Noir, le plus petit des deux, maintient l’accent sur la révolution agraire, suivant la ligne traditionnelle de Terre et Liberté, mais l’organisation meurt quasi immédiatement : les conditions politiques permettent difficilement une activité d’organisation semi-ouverte parmi la paysannerie. Àssez rapidement, les éléments les plus combatifs quittent le Partage Noir et rejoignent La Volonté du Peuple, sans pour autant renoncer à la perspective d’une révolution sociale. Ceux et celles qui restent finissent par créer en 1883 le premier groupe marxiste russe, l’Emancipation du Travail.
Vera Zassoulitch fait partie de ceux-là, même si elle critique durement la croyance de Marx selon laquelle le socialisme doit forcément être précédé par une industrialisation (capitaliste), mettant l’accent sur l’autonomie communautaire déjà existante parmi la paysannerie russe (qui constituait l’écrasante majorité du peuple). Compte tenu de son attaque contre Trepov, on aurait pu s’attendre à ce qu’elle rejoigne La Volonté du Peuple, principale organisation à mettre en place la lutte armée. Mais Zassoulitch ne partage pas son programme politique et reste farouchement attachée à la perspective de révolution sociale. Par conséquent, elle considère le recours incontournable à l’action armée dans cette optique-là, plutôt que de la considérer comme un levier pour forcer un changement de régime politique. Lors de la scission, elle adhére donc au Tscherni Peredel. Opposée à la « lutte politique », le programme de Tscherni préconise plutôt la « terreur économique » : des attaques dirigées non pas contre le gouvernement central, mais contre les ennemis du peuple au niveau local – propriétaires d’usines, propriétaires terriens, fonctionnaires de police ou administrateurs. Les années auparavant, la « terreur économique » constitue le fil conducteur de l’action des révolutionnaires dans le sud de la Russie, dans les milieux des buntari (« rebelles », « émeutiers ») d’inspiration bakouniniste.
C’est cette ligne d’action qui attire Elisabeth Kovalskaïa au sein de l’organisation. Mais Partage Noir se révèle incapable et même peu désireuse de la mettre en œuvre. Un membre de son organe central rejette catégoriquement la proposition de Kovalskaïa de reprendre (ou plutôt, de continuer et d’intensifier) la terreur économique dans le sud de la Russie. Elle quitte alors l’organisation et, avec un camarade, forme une nouvelle organisation, l’Union des ouvriers de la Russie méridionale. Peut-être plus que tout autre révolutionnaire de l’époque, Kovalskaïa réussit à lier une certaine conception de la lutte armée et l’organisation de masse – en l’espace de six mois, elle organise environ sept cents travailleurs au sein de l’Union.
La faction « politique » de Terre et Liberté, rejointe par des vétérans d’autres groupes, forme donc la Volonté du Peuple. La création de ce parti entraîne une transformation majeure du mouvement populiste, en raison de l’abandon explicite de l’organisation paysanne en faveur de la révolution politique. De plus, avec sa discipline et sa centralisation stricte, La Volonté du Peuple devient le premier parti de « révolutionnaires professionnels » de l’histoire de la Russie. Cette transformation a mis du temps à se consolider – plus d’un an, selon Vera Figner. Olga Liubatovich, membre du comité exécutif depuis sa création, ne peut se résoudre à embrasser l’évolution qu’elle voit se produire au cours de cette période. Pour elle, La Volonté du Peuple s’oriente de plus en plus vers le jacobinisme, c’est-à-dire vers une révolution menée par un petit groupe éclairé qui décréte les transformations sociales d’en haut, plutôt que de se fonder sur les forces populaires. En outre, elle estime que le parti cautionne un retour au « netchaïevisme », c’est-à-dire que les décisions principales sont prises au sein d’un petit comité sans véritable possibilité de remise en question. Àu début de l’année 1880, elle finit par quitter le parti.
Praskovia Ivanovskaïa et Vera Figner, quant à elles, restent dans l’organisation. Ivanovskaïa est compositrice dans l’imprimerie du parti et ses mémoires constituent un témoignage inestimable sur les routines quotidiennes et les relations personnelles dans la vie clandestine. Figner est l’une des dirigeantes de La Volonté du Peuple et prend une part active à plusieurs tentatives d’assassinat du tsar, qu’elle décrit dans les extraits de son autobiographie repris dans ce livre.
L’histoire de La Volonté du Peuple est indissociable de la campagne visant à abattre le tsar Alexandre II. Commencée à l’automne 1879, cette campagne a duré beaucoup plus longtemps et a eu des conséquences beaucoup plus lourdes que le parti ne l’avait prévu : elle a donné lieu à sept tentatives distinctes en l’espace d’un an et demi, a drainé toutes les énergies du parti au détriment de l’activité d’organisation. Elle a ainsi exclu toute possibilité de construire un mouvement de masse capable de maximiser l’impact politique et sociale de l’assassinat du tsar. Le succès vient enfin avec un attentat à la bombe le 1er mars 1881. Mais il est suivi presque immédiatement par une vague d’arrestations qui met le parti sur la défensive et l’empêche de remporter son plus grand triomphe à une époque où de larges pans de la société libérale lui sont favorables et même désireux de l’aider. Àu milieu de l’année 1882, Vera Figner est le seul membre de la direction initiale du parti encore en liberté en Russie. Sa capture en février 1883 met fin à la vie effective de La Volonté du Peuple.
III
Au début de cet essai, nous avons évoqué certaines des conditions historiques particulières qui ont permis aux femmes de jouer un rôle aussi extraordinaire dans le mouvement révolutionnaire russe des années soixante-dix : avant tout, le fait que la libération des femmes soit une préoccupation majeure du radicalisme russe depuis un certain nombre d’années, que les femmes aient pu développer leurs idées, construire une sororité et agir en autonomie avant de rejoindre un mouvement révolutionnaire mixte, et que le mouvement populiste, à son tour, ait été sensibilisé à l’importance des relations réciproques et libertaires entre camarades. Ces conditions ne suffisent cependant pas à expliquer la vénération que les femmes des années soixante-dix inspiraient à la fois à leurs camarades masculins et à la société russe éduquée dans son ensemble. Les noms que les contemporains leur ont donnés – « saintes », « amazones moscovites », « Valkyries russes » – sont tous quelque peu inadéquats : premières femmes révolutionnaires de l’histoire russe, elles ont créé leur propre mythologie. Elles possédaient une vision éthique passionnée et lucide que ni l’exil, ni l’emprisonnement, ni la mort imminente n’ont pu détruire.
Sofia Perovskaïa, la première femme de l’histoire russe à être exécutée pour une action révolutionnaire, l’a dit simplement. « Je ne regrette pas mon destin, » écrit-elle à sa mère à la veille de son exécution. « Je l’affronterai calmement, car j’ai longtemps vécu en sachant qu’il arriverait, tôt ou tard. Et vraiment, chère maman, mon destin n’est pas si sombre que cela. J’ai vécu selon mes convictions, je n’aurais pas pu agir autrement, et j’attends donc l’avenir avec une conscience sereine. »
Introduction traduite et retravaillé de
Five Sisters : women against the tsar. The memoirs of five young anarchist women of the 1870’s, Barbara Alpern Engl & Clifford N. Rosenthal,
editions Knopf, 1975 (New York).